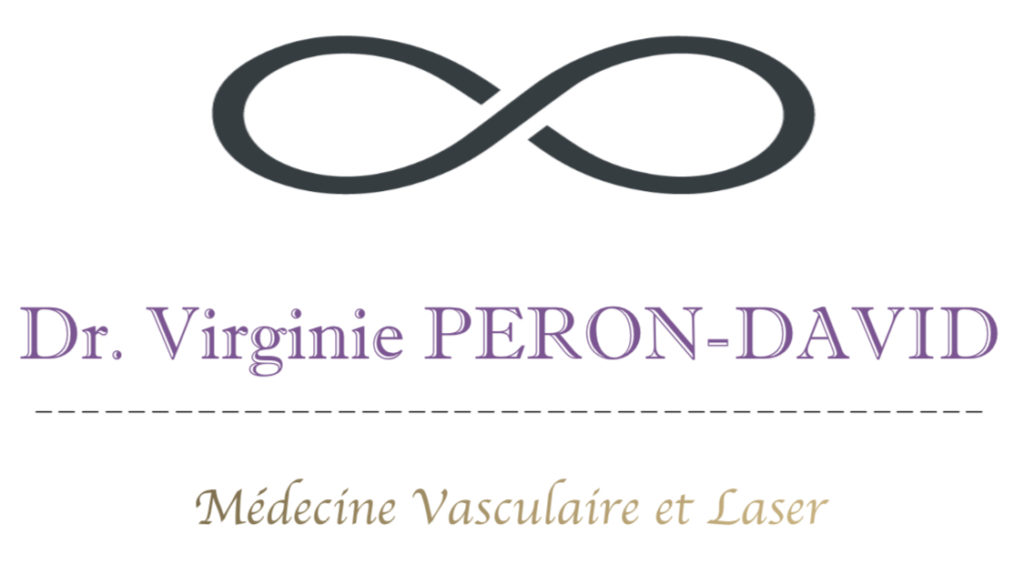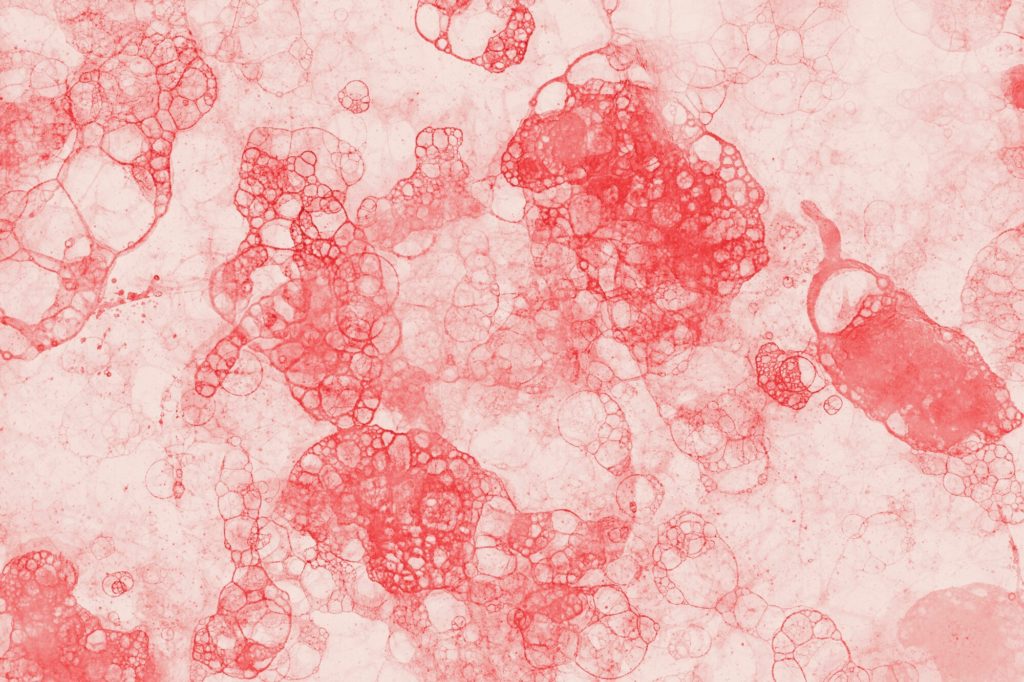
Pathologie microcirculatoire
Le syndrome de Raynaud
Un acrosyndrome est un trouble lié à une réaction des vaisseaux des doigts et/ou des orteils. Il regroupe plusieurs pathologies, permanentes ou paroxystiques. La maladie de Raynaud est un trouble de la circulation sanguine (arrêt temporaire de la circulation sanguine) dans les extrémités, le plus souvent les doigts.
Elle est due à un spasme des petits vaisseaux sanguins, le plus souvent en lien avec le froid, qui bloque temporairement la circulation du sang. Selon son origine et ses conséquences, on distingue deux formes de maladie de Raynaud. La forme dite «primitive» et la forme dite «secondaire», conséquence d’une autre maladie.
Le froid déclenche pâleur, froideur et perte de sensibilité pendant une durée allant de quelques minutes à quelques heures. Dans 90 % des cas, la maladie de Raynaud est sans gravité et disparaît après quelques années. Parfois, elle est la conséquence d’une autre maladie, le plus souvent auto-immune. Les travailleurs de certains secteurs professionnels sont davantage exposés au risque de développer une maladie de Raynaud.
Quelles sont les causes de la maladie de Raynaud ?
Forme primitive :
La maladie de Raynaud est due à une cause inconnue, on dit qu’elle est « idiopathique ». Les symptômes sont provoqués par le froid (sur les mains mais aussi parfois sur d’autres régions du corps). Ils sont spontanément réversibles et n’ont aucune conséquence sur la santé en général. Cette forme affecte principalement les femmes âgées de 20 à 30 ans.
La maladie de Raynaud primitive est liée à une hypersensibilité de certains récepteurs situés sur les membranes des cellules qui forment les petits vaisseaux sanguins, et à des perturbations des médiateurs chimiques qui déclenchent la contraction de ces vaisseaux en réponse au froid.
Les vaisseaux sanguins situés dans la peau et les extrémités (doigts, orteils, oreilles, lèvres, nez) se contractent sous l’effet du froid pour ramener le sang à l’intérieur du corps et garder ainsi constante notre température corporelle. Normalement, cette contraction (la vasoconstriction) n’est pas complète et les extrémités continuent d’être légèrement irriguées par le sang.
Dans la maladie de Raynaud, la vasoconstriction est totale, ce qui prive les extrémités d’oxygène et conduit aux symptômes de cette maladie. L’origine de cette vasoconstriction excessive est inconnue. Elle se produit lorsque les extrémités sont exposées au froid, ou à l’alternance soudaine entre le chaud et le froid.
Forme secondaire
La maladie de Raynaud peut être causée par des médicaments, des toxiques ou d’autres maladies, le plus souvent une maladie auto-immune (où le système immunitaire attaque certains organes) dont les connectivites parmi lesquelles la sclérodermie systémique. Cette forme peut entraîner des complications (apparition d’ulcères sur les doigts qui peuvent se nécroser). Elle touche les personnes d’un âge souvent plus avancé que la forme primitive, en général des personnes de plus de 40 ans.
Les maladies qui sont à l’origine de la forme secondaire de la maladie de Raynaud modifient l’élasticité des petits vaisseaux sanguins, ainsi que certaines caractéristiques du sang (viscosité, déformabilité des globules rouges, activité des plaquettes sanguines, etc.). Ces anomalies augmentent le risque de développer les symptômes de la maladie de Raynaud en contribuant à bloquer complètement la circulation sanguine lorsque les extrémités sont exposées au froid.
Plusieurs maladies peuvent induire la maladie de Raynaud dite secondaire. Ces maladies sont :
• la sclérodermie, une maladie auto-immune qui se traduit par un épaississement et un durcissement de la peau et de certains organes, et dont 90 % des patients présentent une maladie de Raynaud ;
• la connectivite mixte, ou syndrome de Sharp, une maladie du tissu qui relie les cellules (tissu conjonctif), où 85 % des patients sont touchés par la maladie de Raynaud ;
• le lupus systémique ou le lupus érythémateux disséminé, des maladies auto-immunes, dont 30 % des patients souffrent de maladie de Raynaud ;
• le syndrome de Gougerot-Sjögren, qui se traduit par une sécheresse des muqueuses de la bouche, des yeux et du vagin, dont 30 % des patients présentent également une maladie de Raynaud.
• La polyarthrite rhumatoide , qui touche les articulations ;
• la dermatomyosite et la polymyosite (des inflammations de certains muscles et zones de la peau).
D’autres maladies peuvent augmenter le risque de développer une maladie de Raynaud secondaire : syndrome du canal carpien, troubles de la thyroïde, athérosclérose (dépôt de plaques de cholestérol dans les artères), maladie de Buerger (inflammation de certains vaisseaux qui se bouchent, empêchant la circulation normale du sang dans les pieds et les mains), etc.
Les travailleurs de certains secteurs professionnels sont davantage exposés au risque de développer une maladie de Raynaud :
• les personnes qui exposent leurs mains à des traumatismes répétés : journées passées à utiliser un clavier d’ordinateur ou de piano, usage de la paume de la main pour écraser, presser ou tordre des objets (maçons, carreleurs, couvreurs, menuisiers, par exemple) ;
• les ouvriers des usines de plastique qui sont exposés au chlorure de vinyle
• les personnes qui manipulent de la glace ou de tout autre produit réfrigérant, ainsi que celles qui entrent et sortent de chambres froides tout au long de la journée ;
• les ouvriers qui utilisent des outils mécaniques générant des vibrations (tronçonneuses, marteaux piqueurs, perforateurs pneumatiques, etc.)
Quels sont les facteurs de risque de la maladie de Raynaud ?
Différents facteurs peuvent favoriser ou déclencher la maladie de Raynaud.
Outre le fait d’être une jeune femme, d’autres situations peuvent augmenter la probabilité de souffrir d’une maladie de Raynaud :
• vivre dans une région froide et humide ;
• pratiquer des activités de plein air en période de grand froid ;
• avoir subi des engelures au niveau des extrémités ;
• avoir un apparenté du premier degré (parent, frère, sœur, enfant) qui souffre d’une maladie de Raynaud primitive (augmentation de 30 % du risque) ;
• fumer du tabac ou du cannabis ;
• prendre certains drogues comme la cocaïne, les amphétamines ou le LSD ;
• prendre certains médicaments, par exemple contre les maladies cardiaques, le rhume, les cancers ou les migraines ;
• chez les femmes, utiliser un mode de contraception hormonal contenant des estrogènes et de la progestérone (pilule, implant, etc.) ;
• enfin, dans certains cas, le stress ou les émotions fortes peuvent déclencher une crise.
Quels sont les premiers symptômes ?
La maladie de Raynaud touche le plus souvent les doigts, parfois les orteils, le lobe des oreilles, le nez ou les lèvres. Elle se traduit par :
• une phase blanche ou syncopale avec contraction ou spasme des vaisseaux sanguins : les parties touchées deviennent blanches, froides et insensibles ;
• une phase bleue ou cyanique où la peau des parties touchées bleuit du fait du phénomène de stase ;
• une phase rouge ou érythrosique : correspondant à une reperméabilisation avec un retour du sang avec de la rougeur, des sensations de type brûlure, des fourmillements, des pulsations, voire un gonflement.
Ces trois phases se succèdent sur une durée totale de quelques minutes à quelques heures.
Dans certains cas, seule la première phase est présente, suivie d’un retour rapide à la normale.
La forme primitive de la maladie de Raynaud touche en général les deux mains et épargne les pouces. Lorsque la maladie de Raynaud est secondaire à une autre maladie, elle peut toucher une seule main et affecter le pouce. Cette dernière forme provoque souvent des symptômes plus intenses et prolongés que la forme primitive.
Quelles sont les complications de la maladie de Raynaud ?
Les complications de la maladie de Raynaud sont essentiellement observées dans les formes secondaires. Elles se traduisent par l’apparition d’ulcères, voire de nécroses, sur la peau des doigts touchés par cette maladie.
Comment fait-on le diagnostic ?
Son diagnostic est simple et afin de s’assurer de son caractère primitif, il est important de consulter votre médecin traitant, qui vous orientera si besoin vers un médecin vasculaire pour réaliser les examens complémentaires : écho doppler, capillaroscopie. Il est important de se faire suivre régulièrement tant l’apparition d’une maladie associée peut être retardée par rapport au syndrome de Raynaud.
Quelles sont les mesures préventives ?
Il n’existe que deux mesures générales pour prévenir la maladie de Raynaud :
• éviter les expositions des extrémités au froid ;
• arrêter de fumer.
Les personnes particulièrement exposées par leur activité professionnelle peuvent adopter des mesures spécifiques destinées à éviter les fortes pressions et les vibrations au niveau des paumes et des poignets, ou réduire leur exposition au chlorure de vinyle.
Enfin, les femmes en âge d’avoir un enfant peuvent opter pour une forme de contraception qui ne les expose pas aux estrogènes ou à la progestérone(diaphragme, stérilet au cuivre, par exemple).
Lorsque la maladie de Raynaud est due à une autre maladie, et lorsqu’elle devient une gêne pour la vie quotidienne, le médecin peut prescrire des médicaments destinés à dilater les vaisseaux : inhibiteurs calcique, par exemple, la nifédipine, ou des prostaglandines, par exemple, l’iloprost en injection intraveineuse.
Ces médicaments ont pour objectif de lutter contre la phase de vasoconstriction initiale.
Lorsqu’on souffre de maladie de Raynaud, des mesures simples peuvent réduire la fréquence des crises :
• arrêter de fumer ;
• se protéger du froid sur l’ensemble du corps (préférez la technique « multicouches ») et porter des moufles (plutôt que des gants) qui permettent aux doigts de bouger et de se réchauffer mutuellement ;
• lorsque l’on doit aller dehors par temps très froid, utiliser des sachets chauffe-mains dans ses gants (disponibles dans les pharmacies, les magasins de chasse et de pêche, et ceux d’articles de sport) ;
• éviter les changements brusques de température du chaud vers le froid ;
• user modérément de la climatisation ;
• porter des gants isolants pour manipuler des aliments ou des objets froids ;
• éviter les bijoux serrés (bagues, bracelets), ainsi que les chaussures serrées ;
• éviter de porter des charges à la main (qui coupent la circulation dans les doigts) ;
• consulter la notice des médicaments que l’on prend pour identifier si la maladie de Raynaud est un de leurs effets indésirables ;
• éviter les boissons riches en caféine (qui font se contracter les petits vaisseaux sanguins) comme le café, le thé, le chocolat, les colas, etc. ;
• éviter de prendre des médicaments contre le rhume, disponibles sans ordonnance, contenant de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine ;
• faire régulièrement de l’exercice (pour activer la circulation sanguine et lutter contre le stress).
Les autres acrosyndromes
L'acrocyanose
L’acrocyanose est un acrosyndrome vasomoteur à type de cyanose ou érythématose, très persistante, non douloureuse, volontiers associé à une hyperhydrose et symétrique des mains, des pieds ou du visage.
L'érythermalgie
Acrosyndrome vasculaire paroxystique avec vasodilatation entrainant des extrémités rouges, et chaudes (d’erythros : rouge, thermos : chaud, algos : douleur) et des douleurs quotidiennes extrêmes des extrémités, les pieds généralement, le plus souvent bilatérales et symétriques, à types de brûlures, de piqûres et de lacérations, déclenchées par la chaleur dès 22 degrés, la station debout, la marche même très lente et sur une très courte distance, et toute activité même modérée (monter un étage, faire le ménage, la cuisine, etc.). Par ailleurs les douleurs se déclenchent spontanément toutes les nuits dès que le patient tente de s’endormir, perturbant grandement le sommeil et occasionnant une fatigue intense.
La phase d’endormissement créant en effet une légère vasodilatation, cela suffit pour les patients atteints de cette pathologie à déclencher une crise, les empêchant par là même de s’endormir. Des médicaments antidouleurs puissants de palier trois sont souvent nécessaires pour permettre un minimum de sommeil.
Les acrosyndromes trophiques
Engelures (à ne pas confondre avec les gelures) : les engelures se caractérisent par une plaque ou papule oedémateuse, prurigineuse, algique, érythrocyanotique, au niveau des orteils, doigts ou encore aux oreilles, nez, ou joues. Les lésions sont volontiers bilatérales et surviennent au froid humide. Le caractère prurigineux est particulièrement évocateur. L’évolution se fait par poussées de deux ou trois semaines vers la guérison spontanée au printemps, avec rechute possible les années suivantes. Elle peut se compliquer de bulles hémorragiques et d’ulcérations.
• Ischémie digitale permanente : le tableau clinique peut être celui d’un doigt ou d’une extrémité de doigt cyanique ou blanc, froid, souvent associé à de petites hémorragies sous-unguéales.
• Hématome digital spontané
• Syndrome de l’orteil bleu
• Nécrose digitale